Architectures des systèmes informatiques
CHAPITRE 6
Mémoires de masse
Année 2002-2003
6.0 PRÉSENTATION ET CONTENU
Allant de l'intérieur
vers l'extérieur de l'ordinateur, après les caches et la
mémoire centrale câblée sont les mémoires externes
dites aussi mémoires de masse dont une contient la mémoire
virtuelle éventuelle.
Les mémoires de masse,
très différentes les unes des autres, sont habituellement
réparties en trois classes.
Les mémoires de masse primaires sont attachées à l'ordinateur. L'accès aux données est de type bloc à accès direct (random access). Ce sont les disques magnétiques. Les disques dits virtuels en mémoire centrale dont l'utilisation a fortement décru, font partie de ce groupe.
Les mémoires de masse secondaires sont amovibles. L'accès aux données est le même que celui des précédentes. Ce sont les disques amovibles magnétiques et optiques et les disquettes.
Le mémoires de masse de sauvegarde sont amovibles. L'accès aux données est séquentiel. Les bandes magnétiques sont l'exemple le plus connu.
Nous examinons dans la suite les seules mémoires de masse primaires.
Ce chapitre contient :
6.1
PANORAMA DES TECHNIQUES DE STOCKAGE en 1997
Donnons d'abord quelques exemples
de quantités de données :
..œuvres complètes de
Victor Hugo, 60 millions
d'octets;
..annuaire téléphonique
de Paris, 55
millions d'octets;
..annuaire téléphonique
national, 600 millions
d'octets;
..un volume de la collection
de la pléiade, 3 millions d'octets;
..une grande encyclopédie,
hors figures et photographies environ 500 millions d'octets, le texte complet
de l'Encyclopædia Universalis tient sur un CD-ROM.Les
indications ci-dessous ne sont que des ordres de grandeur qui devraient
être et ne sont pas actualisées fréquemment.
| Technique |
|
|
Fournisseurs | Observations | ||||||
| Magnétique | ||||||||||
| Disquette |
|
|
Teac, Mitsumi, etc. | Insuffisant | ||||||
| Disquette haute densité |
|
|
Ioméga, Imation, Sony, Fujitsu | Pas de standard | ||||||
| Disque fixe |
|
|
Seagate, Quantum, Western digital | |||||||
| Disque amovible |
|
|
Syquest, Ioméga | cartouche normalisée | ||||||
| Bande en cartouche |
|
|
IBM Philips | pas de standard | ||||||
| Optique 12 cm | ||||||||||
| CD-Rom |
|
|
asiatiques | normalisé lecture seule | ||||||
| CD-R |
|
|
Philips, asiatiques | inscriptible 1 fois | ||||||
| CD-RW |
|
|
Philips, Sony, Ricoh | effaçable | ||||||
| DVD-Rom |
|
|
Philips, asiatiques | normalisé,
images seules |
||||||
| DVD-R |
|
|
Pioneer | |||||||
| DVD-Ram |
|
|
Toshiba, Matsushita | |||||||
| DVD-RW |
|
|
Philips, Sony | |||||||
| Optique autres tailles | ||||||||||
| 2,5 pouces |
|
|
Philips, Yamaha, Olympus, Fujitsu | magnéto-optique | ||||||
| 5,25 pouces |
|
|
Hitachi, Maxoptic | magnéto-optique | ||||||
| 12 pouces |
|
|
Philips ATG | inscriptible une fois | ||||||
DVD (CD-ROM à laser orange)
: 4,5 Go, 9 Go en double face.
Bande d'«optical paper»
: 2 To.
Disque magnéto-optique
à venir : 60 Go et plus.
En 1956, IBM a produit le premier disque nommé IBM 305 ou RAMAC pour «random access method of accounting and control» déjà cité, cette dénomination est toujours utilisée pour des systèmes de disques par le même constructeur. Le disque magnétique a été nommé DASD pour «direct access storage device», dans ses débuts. L'expression disque dur est arrivée plus tard pour les distinguer des disques souples ou disquettes, «floppy disks».
Le tableau ci-dessous donne l'évolution des différentes densités chez un même constructeur de 1957 à 1981. La densité de surface a été multipliée par 6000 en 24 ans. Elle atteint aujourd'hui 8 Gbits/cm².
Densités de stockage de quelques disques anciens d'IBM
| Année | Nom | Densité de surface Mbit/cm² | Densité linéaire bits/cm | Densité des pistes piste/cm |
| 1957 | IBM 350 |
0,013
|
253
|
51
|
| 1961 | IBM 140 |
0,058
|
557
|
102
|
| 1962 | IBM 1301 |
0,017
|
1316
|
126
|
| 1963 | IBM 1311 |
0,033
|
2593
|
126
|
| 1966 | IBM 2314 |
1,41
|
5566
|
523
|
| 1971 | IBM 3330 |
4,99
|
10220
|
486
|
| 1973 | IBM 3340 |
10,8
|
14260
|
760
|
| 1976 | IBM 3350 |
19,6
|
16255
|
1210
|
| 1979 | IBM 3370 |
49,9
|
30700
|
1606
|
| 1981 | IBM 3380 |
76,8
|
37950
|
2026
|
On estime que dans les années à venir comme dans les années passées, les disques magnétiques gagneront 15% par an en performances temporelles alors que les processeurs progresseront de 50%.
Les consommations électriques courantes ont évolué comme suit :
| Année | Consommation | Tension |
| 1980 | 25 W | 12 V |
| 1984 | 20 W | 12 V |
| 1987 | 15 W | 12 V |
| 1989 | 10 W | 12 V et 5 V |
| 1991 | 02 W | 5 V |
| 1994 | 01,3 W | 3,3 V |
Évolution des prix
de quelques disques Winchester
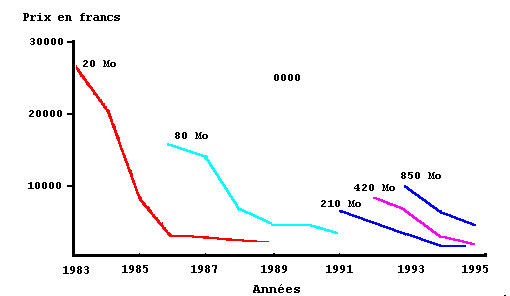
6.2.1 Principe de fonctionnement et organisation physique des disques dits Winchester
Le boitier contient :.les
plateaux, médium rigide, couramment jusqu'à une dizaine,
solidaires par un axe commun;
.le moteur d'entraînement;
.le chariot porte têtes
et les têtes de lecture et d'écriture;
.la carte de commande qui régule
la rotation, commande le chariot et code et décode les données,
à distinguer de la «carte contrôleur» attachée
au bus qui gère le bus d'accès
au(x) disque(s).
Un plateau, disque
longtemps fait d'un alliage d'aluminium et de magnésium ou en verre
simple ou composite, couvert de couches métalliques. Les plateaux
sont montés sur un même axe, couramment 3 (IBM Deskstar) à
10 (Seagate Barracuda).
Le plateau est d'abord recouvert
d'une couche de nickel de 15 µm d'épaisseur, puis d'une couche
de phosphore-cobalt ou de phosphore-nickel-cobalt magnétique de
moins de 0,1 µm d'épaisseur. Le dépôt est fait
par électrlyse ou par phase vapeur.La planéité exigée
est de moins de 0,012 µm. Le dépôt de particules d'oxyde
de fer avec un liant est abandonné.
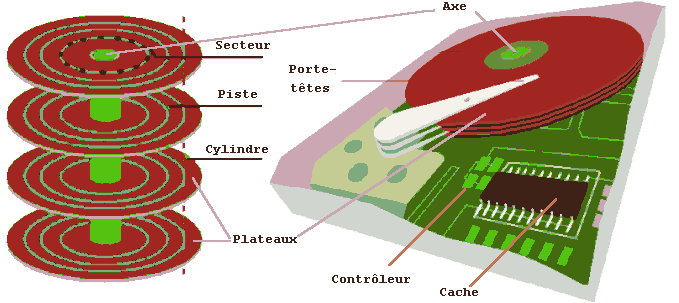
Le moteur entraîne les plateaux par leur axe commun. Sa vitesse de rotation est constante. Elle fut longtemps de 3600 t/min, entre 3560 à 3590 t/min. On observe 5400, 6400, 7200 et 10000 t/min. Le disque Cheetah X15 UltraScsi, 18 Go, de Seagate tournait à 15000 t/min en 2000.
Les têtes de lecture et écriture à raison d'une par face de plateau, sont portées chacune par un bras souple dont la géométrie est étudiée pour réduire les effets de roulis et de tangage de la tête. Les bras sont entraînés par un chariot porte têtes commun. La tête est profilée pour voler à la surface du plateau sur un coussin d'air à une distance de 0,25 µm environ. Ce coussin, produit par l'effet d'entraînement du plateau tournant dans une atmosphère raréfiée et épurée est l'essentiel de la technique dite Winchester apparue en 1971.
La partie utile de la tête
est un film mince sur substrat de verre. Du permalloy, matériau
magnétique, y est déposé en spires formant bobine.
Le dépôt est fait par masquage selon une technique analogue
à celle de la fabrication des circuits intégrés. Cette
tête peut distinguer 800 pistes par cm et 8000 transitions magnétiques
par cm linéaire de piste. La technique du tore de ferrite
enrobé dans un matériau composite à base de céramique
est abandonnée.
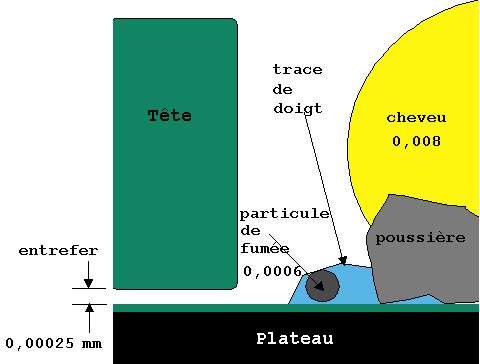
L'écriture
est faite en appliquant un courant à la bobine. La variation de
courant crée un champ magnétique qui impose une orientation
aux domaines du matériau magnétique. C'est une application
directe de la loi de Lenz.
La lecture est faite selon deux procédés, inductif ou magnéto-résistif auxquels correspondent deux organes de lecture.
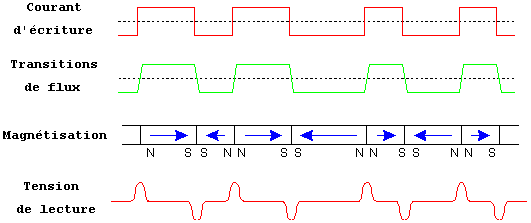
Mais où est la bonne piste ? Le pistes ont un numéro d'ordre induit par le parcours des têtes lors du formatage initial. Cet ordre a trois réalisations.
L'ordre vertical : les
enregistrement sont faits sur les pistes successives d'un même cylindre
de tête en tête, puis sur le cylindre suivant, plus intérieur
d'une unité que le précédent.
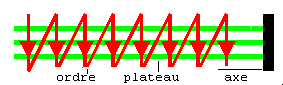
L'allure des courbes de débit
et de temps d'accès moyen est :
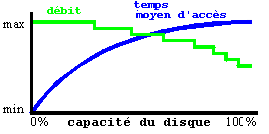
L'ordre horizontal : toutes
les pistes d'une même face d'un plateau sont parcourues avant de
passer à la face suivante puis au plateau suivant.
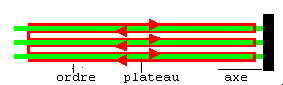
L'allure des courbes de débit
et de temps d'accès moyen est :
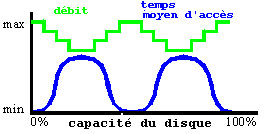
Les autres ordres : combinent
le vertical et l'horizontal, par exemple :
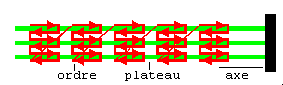
Les courbes de temps d'accès
et de débit n'ont pas d'allure générale typique.
Un moteur pas-à-pas déplaçait les têtes sur un rayon de la pile de plateaux. Aujourd'hui, le bras est en rotation autour d'un axe parallèle à celui des plateaux. Une bobine commandée en courant et maintenue immergée dans un aimant permanent (dit «voice coil») commande cette rotation. Le placement des têtes sur un cylindre est fait par asservissement comme suit : une ou la tête lit un enregistrement particulier nommé cale, la différence entre la meilleure position de la ou des têtes et la position en cours est calculée et l'angle du chariot porte têtes est modufié. Les cales sont logées :
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES PRINCIPALES D'UN DISQUE :
Nombre de plateaux;
Nombre de têtes ou de
faces;
Nombre de tours par minute;
Nombre de pistes par face;
Nombre de secteurs par piste;
Temps
d'accès moyen, parcours de la moitié des deux tiers du
disque;
Temps d'accès de piste
à piste;
Nombre de secteurs d'une piste
lus en une rotation;
Densité linéaire
de bits sur une piste;
Taille du cache.
L'adressage
des secteurs était depuis l'origine organisé par cylindre/tête/secteur,
CHS pour «cylinder/head/sector». Un mode nouveau pour les PC
est l'adressage logique par bloc, LBA pour «logical block addressing».
Il utilise un nombre unique pour repérer les secteurs de façon
consécutive. Ce mode a été introduit pour l'accès
de type IDE au format ATA-2. Il est commun dans la norme SCSI. Un numéro
composite CHS et un numéro LBA se transforment réciproquement
par :LBA= (N°
de secteur-1) + (N° de tête * Nbre secteurs) + (N° de cylindre
* (Nbre de têtes+1)* Nbre total de secteurs).et
N° de secteur
= ((reste de LBA/nombre total de secteurs) +1)
Cylindre-tête
= (dividende de LBA/nombre total de secteurs)
N° de cylindre
= (dividende de cylindre-tête/(Nbre total de têtes + 1))
N° de tête
= (reste de cylindre-tête/(Nbre total de têtes + 1))
Quelque soit le moyen employé,
l'adressage est fondé sur une numérotation des emplacements
qui introduit la relation
d'ordre omniprésente en informatique.
Certains nomment cela
«linéarisation de l'espace».
Conservatoire national des arts et métiers
Architectures des systèmes informatiques
CHAPITRE 6
Mémoires de masse
Année 2002-2003
![]()
![]()