Architectures des systèmes informatiques
CHAPITRE 1
Origine et évolutions des architectures
Année 2002-2003
Le passé est le prologue de l'avenir
W. Shakespeare
1.2
L'HISTOIRE SIMPLEMENT ANCIENNE ou les ancêtres récents.
| Le premier
et probablement le plus grand de ces ancêtres est l'anglais Charles
Babbage (1792-1871), professeur de mathématiques à l'université
de Cambridge de 1827 à 1839. Il avait reçu en 1821 la première
médaille d'or de la British Astronomical Society pour un article
intitulé «Observations on the application
of machinery to the computation of mathematical tables».
À partir de 1822, il tente d'unir la mécanisation du calcul et l'automatisation de la commande. En 1823, il nomme Difference engine sa première machine de deux tonnes qui est destinée à calculer les positions des planètes et du soleil ainsi que des tables de marine. |
 |
Il a reçu pour cela le
soutien de son gouvernement qui le lui retire en cours de réalisation.
On observe ainsi trois nouveautés:
..la capacité financière
d'un individu est insuffisante pour construire une machine;
..le financement public est
sollicité et obtenu;
..la troisième a un grand
avenir, les pouvoirs publics se retirent au milieu du gué sans aucun
profit.
Babbage n'aboutit pas complètement. Néanmoins, sous une forme plus simple, cette machine sera fabriquée par deux suédois Pierre Georges Scheutz le père et Édouard son fils (1785-1873) avec l'aide de l'Académie royale des sciences de Suède. Ils la présenteront à l'exposition universelle de Paris en 1855. Elle résout les équations polynomiales de degré 6, en débitant 33 à 44 nombres de 32 chiffres par minute. Elle est aujourd'hui visible au Smithsonian Institute.
C. Babbage conçoit une deuxième machine évidemment mécanique, à partir de 1833, Analytical Engine. Son inspiration première peut être venue du métier à tisser de Jacquard car elle emploie des cartes perforées pour contenir le programme à exécuter et les données à traiter.
Cette machine sera à usage général, elle pourra faire toutes sortes de calculs; on pourra emmagasiner des données dans le «magasin» qu'elle lira dans n'importe quel ordre; elle conservera les nombres produits en cours de calcul. Une unité de commande gèrera l'ordre des instructions et un «moulin» fera les opérations de calcul. Le dispositif d'entrée sera un carton perforé sur lequel l'utilisateur aura enregistré le programme et l'aura fourni à la machine pour chaque exécution. Il s'agit donc bien d'un programme enregistré quoiqu'encore séparé des fonctions de calcul et de stockage des données intermédiaires. La précision prévue était de 50 décimales; 1000 nombres devaient pouvoir y être emmagasinés. La machine devait avoir 50 000 pièces mobiles. [BAB]C. Babbage avait en tête un troisième type de machine mais nous n'en avons pas de description.
| Dans les années 1980, Allan Bromlym a eu l'idée de construire la Difference Engine II, deuxième version de la première machine. Cela a été achevé en 1991 par le Musée des sciences de Kensington en Grande-Bretagne, pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Babbage, avec les matériaux et les techniques de l'époque. La machine fonctionne et est exposée au Musée des sciences (Science Museum) à Londres. Elle pèse 3 tonnes, a 2,3 m. de hauteur et comporte 4 000 pièces en bronze et en acier. Elle a apporté la preuve de la viabilité des idées de C. Babbage. |  |
L'un des mérites de Babbage a été d'imaginer un système de cartes perforées pour emmagasiner les instructions données à la machine, à raison d'une carte par instruction; d'autres cartes devaient contenir les adresses du registre ainsi que les données. Ces cartes devaient être aussi réutilisables. Babbage n'avait cependant pas imaginé qu'une instruction puisse contenir à la fois une opération à effectuer et une adresse; il n'avait pas imaginé la programmation comme on la connaît aujourd'hui ni l'idée de conserver un programme d'instructions en mémoire.
Pour la construction de sa machine analytique, Babbage a reçu les encouragements permanents d'Ada Augusta King (1816-1852), comtesse de Lovelace. Elle s'est passionnée pour cela et a écrit des programmes à partir des plans que lui a envoyé C. Babbage. Elle est considérée comme la première programmeuse. Le langage Ada sera nommé de son premier prénom.
On lira ci-dessous l'opinion d'un scientifique éminent sur la numération binaire en 1850.
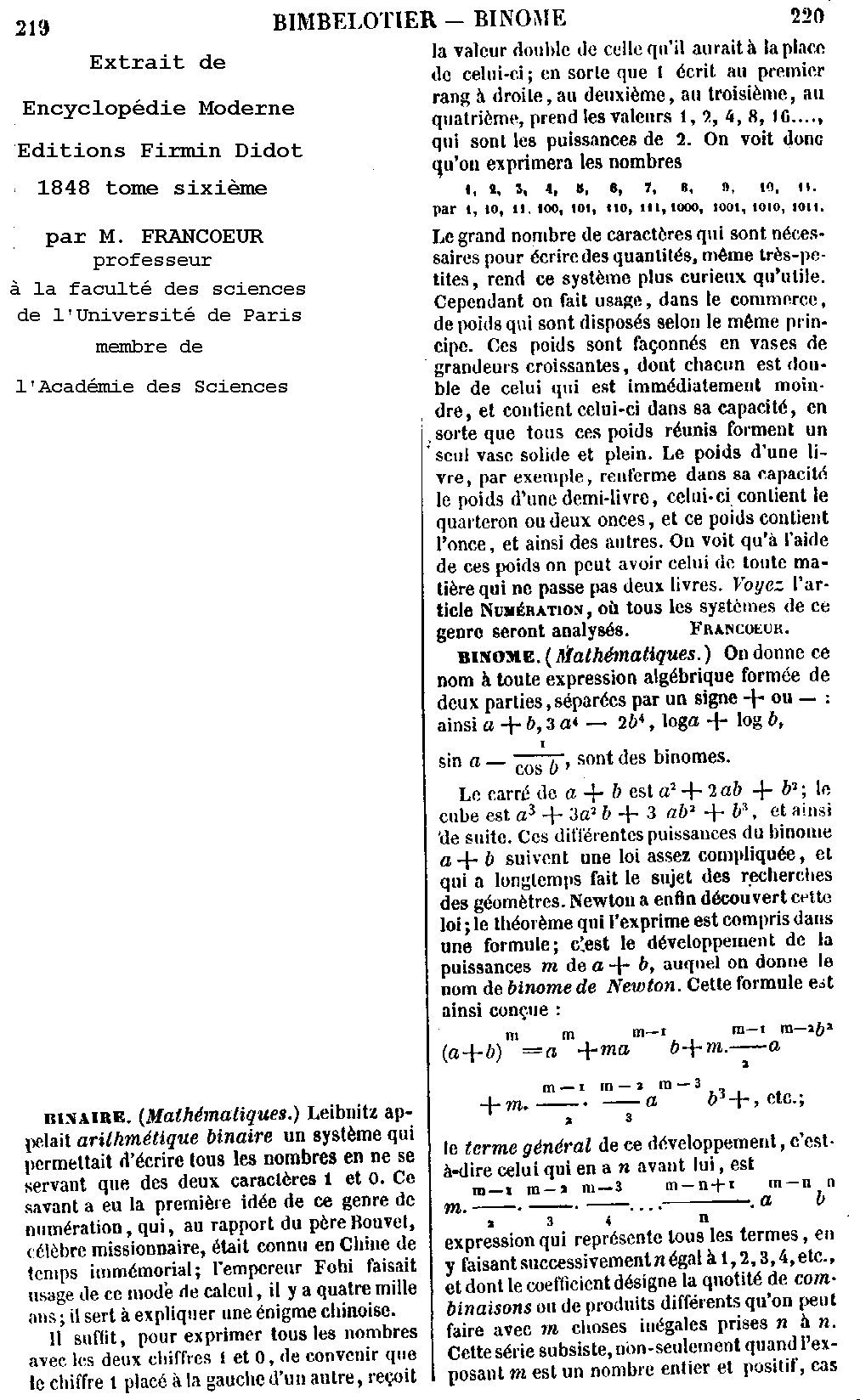
En 1837, un pas est franchi en matière de logique par Bernard Bolzano (1781-1848), théologien et mathématicien. Il se propose d'utiliser la logique pour exposer les mathématiques et la rendre apte à porter l'édifice mathématique.
Le grand réveil public de la logique est apporté par le mathématicien anglais George Boole (1815-1864), professeur en Irlande. Il publie en 1847, un essai intitulé: «L'analyse mathématique de la logique, un essai en vue du calcul appliqué au raisonnement déductif» (The mathematical analysis of logic, being an essay towards a calculus of deductive reasoning), puis en 1854 : «Une étude des lois de la pensée» (An investigation of the laws of thought on which are founded the mathematical theories of logic and probabilities).
Il conçoit, non pas un codage ni une représentation numérique, mais l'algèbre qui portera son nom. Il écrit au début du livre de 1854 : «[J'entends] étudier les lois fondamentales de l'esprit selon lesquelles le raisonnement s'accomplit; exposer ces lois dans le langage symbolique du calcul et, sur cette base, établir la science de la logique et construire sa méthode». Par là, il réussit à faire de la logique une discipline mathématique en lui apportant les procédures de décision. Il applique le premier la logique aux faits et non plus seulement aux choses. [BRU81]
La plus simple de ces algèbres a deux symboles que l'on peut noter comme l'on veut, OUI et NON ou 0 et 1 et trois opérateurs ET, OU et PAS. La représentation binaire de chiffres ou de symboles, ainsi que leurs règles opératoires deviennent alors un cas particulier d'une classe d'algèbres. La contribution extraordinaire de Boole est d'avoir, en voulant mathématiser les lois de la pensée, produit une algèbre capable de la totalité des calculs envisageables, ou plus précisément de calculer les fonctions que l'on nommera plus tard calculables. Une présentation axiomatique de l'algèbre de Boole est faite dans l'annexe asi0012.
Les derniers perfectionnements notables des machines à calculer à quatre opérations sont introduites dans les Eurta de Baldwin et Ohdner, en 1870, aux États-Unis. Elles seront remplacées par les calculatrices électroniques dans les années 1960.
En 1873, la première machine à écrire mécanique est commercialisée par Remington avec le clavier dit Qwerty qui existe encore aujourd'hui. Ces machines fonctionnent avec des touches dont l'enfoncement projette une barre métallique vers une position toujours la même sous laquelle le chariot fait avancer le papier. Il est préférable que les barres que l'on utilise successivement soient les plus éloignées possibles au repos pour éviter des chocs entre elles. La disposition QWERTY a été choisie en anglais pour cela. En français il valait mieux utiliser un clavier AZERTY.
En 1876, Graham Bell invente le téléphone.
Les premières machines construites pour la gestion ont imaginées aux États-Unis par D.E. Felt et William Burroughs (1857-1898) qui obtient le premier brevet américain d'une machine à additionner. En 1888, leur première machine n'a pas de succès, à cause de sa difficulté d'utilisation. Ils doivent reprendre plusieurs exemplaires vendus. Ils en inventent une autre: «Burroughs adding and listing machine», machine mécanique qui soustrait, additionne et imprime les résultats, elle n'est pas programmable. L'entreprise Burroughs deviendra un des grands de l'informatique.
L'ingénieur Herman Hollerith (1860-1929) entre au bureau du recensement américain en 1880. Il utilise la carte à 80 colonnes. Il obtient ensuite le marché de la construction d'une machine pour dépouiller les résultats des recensements. Elle est faite de relais électromécaniques associés à des cartes manipulées par une perforatrice et une trieuse. Les cartes portent ici les données et non un programme. Il fonde plus tard la «Tabulating machine company» dont le nom sera changé deux fois en CTR (Calculating tabulating recording company) en 1911 et en IBM (International business machines) en 1924.
À la suite d'un différent sur le coût de location de la machine de Hollerith, le Bureau du recensement demande à l'un de ses ingénieurs, James Power, de construire une nouvelle machine. Elle sera dotée de cartes perforées à lecture mécanique. Mais Power quitte aussi le Bureau et crée son entreprise, «The Power's accounting machine company» qui deviendra Remington Rand corporation en 1927 et Sperry-Rand corporation en 1955.
L'enregistreur magnétique est inventé dans les années 1890 par le danois Valdemar Poulsen.
La diode est inventée
par John A. Fleming en 1904.
| En 1907,
l'américain Lee de Forest invente la triode en ajoutant une grille
entre l'anode et la cathode de la diode. Cette grille bien commandée
amplifie le courant ou bloque son passage. La triode a deux états
selon que le courant passe ou ne passe pas. Elle change d'état beaucoup
plus vite qu'un relais électromagnétique.
Ci-contre une triode.
|
 |
La même année une photographie est transmise par bélinographe.
La bascule est inventée sous la forme du montage flip-flop en 1919 par W.H. Eccles et F.W. Jordan.
Avec le recul que nous avons, nous pouvons dire que les composants d'un ordinateur électronique étaient connus en 1920.
La technique ne suffit donc pas, encore faut-il avoir les idées comme Babbage ou les théories. Un ingénieur norvégien, Frederik Rosen Bull (1882-1925) et son associé Knut Kruesen créent en 1922 une société de fabrication de machines mécanographiques. Après la mort de F. Bull en 1929, les brevets sont achetés par le groupe suisse H.W. Egli qui les vend en 1932 à un groupe d'industriels français, Michelin, Caillies (Fives-Lille), Aussedat (papeteries). Ils sont alors exploités par une entreprise nommée Compagnie des machines Bull. Son premier président en 1932 est le colonel Rimailho (1864-1954), un des concepteurs du canon de 75 devenu spécialiste de l'organisation du travail.
La fin du XIXe et
le début du XXe siècle ont vu fleurir les machines
mécaniques ou électromécaniques spécialisées.
| Par
exemple, en 1919, E. Carissan (1880-1925) conçoit et fabrique une
machine qui factorise les nombres entiers [SHA95].
Elle a été retrouvée
récemment et déposée au musée du CNAM qui détient
aussi une magnifique machine d'une spécialisation extrême
: elle est un montage analogique qui détermine la hauteur des marées
à Dakar.
|
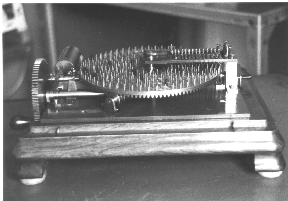 |
Disons maintenant quelques mots de deux inventeurs méconnus.
Un inventeur visionnaire fut l'irlandais Percy Ludgate (1883-1922). Il ne connut les travaux de Babbage qu'après avoir largement progressé dans les siens. Il conçut une machine analytique dont il rédigea la description complète en 1909. Cette machine contenait des inventions remarquables :
Avant d'aborder les événements des années 1930, il est utile de faire une courte digression sur la vision mécaniste du monde à laquelle adhéraient à l'évidence nombre des personnages déjà cités. On verra dans le paragraphe suivant 1.3 que cette fièvre atteignit aussi les mathématiciens.
Le mécanisme n'est pas seulement une idée mais l'idéologie que tout est mécanique, non seulement l'univers physique, mais encore la vie des plantes, des animaux et de l'homme. Cette idée est apparue à la fin de la Renaissance. Depuis lors, elle a imprégné les esprits occidentaux. Descartes en a été l'un des premiers tenants, il y a acquis la célébrité douteuse d'auteur de la théorie des animaux-machines. L'engouement pour le mécanisme a été et reste très fort. La petite histoire dit que, retiré au monastère de Saint Jérôme le Juste pour préparer sa mort prochaine, Charles-Quint n'a conservé auprès de lui qu'un seul serviteur, un homme capable de fabriquer des «mécaniques», horloges et autres appareils complexes. Lord Kelvin (1824-1907) écrit dans «Baltimore lectures on molecular dynamics and the wave theory of light» Londres, 1904 : «Je ne suis jamais satisfait tant que je n'ai pas pu construire un modèle mécanique [...]si je puis faire un modèle mécanique, je comprends; tant que je ne puis pas faire un modèle mécanique, je ne comprends pas.»
Une autre forme du mécanisme est la recherche d'une machine intelligente, le robot, d'un mot polonais qui signifie ouvrier, et de ce que nous nommons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Le robot a des origines anciennes. Héphaïstos, dieu du travail des métaux, avait construit des tables à trois pieds qui se déplaçaient seules dans les palais des dieux. Ce dieu contrefait, malheureux en amour, avait construit une femme en or animée, ainsi que des pièges mécaniques. Le docteur Claude Allard a donné le nom de complexe d'Héphaïstos au désir de formaliser dans le sens de rendre tout mécanique [CIT].
Karl Ludwig Klages (1872-1956)
a mis en évidence le désir de formaliser dans quatre grands
domaines à partir du XVIIe siècle : la finance,
les mathématiques, la technique et le sport.
À propos de la bourse,
il affirme [CIT] : «Les
chiffres y signifient bien quelque chose (terre, pétrole, machines,
chemins de fer, ouvriers, etc.) mais ce sont eux qui vivent dans le cerveau
des lutteurs d'une vie souveraine et non leur valeur significative. Et
c'est pourquoi des batailles engagées pour des chiffres peuvent
décider en un clin d'il du sort de millions d'hommes».
Il conclut : «Le
but de la pensée formaliste, c'est:
.des
résultats de la pensée atteints sans l'effort de la
pensée,
.des
réponses trouvées sans l'intermédiaire de la
recherche...
Le
parfait formaliste serait un appareil de précision sans conscience,
capable d'une variété de réactions inquiétante
et qu'on pourrait alors composer, soit dans un atelier de construction,
soit dans un alambic.»
Les
controverses sur le mécanisme sont toujours d'actualité et
la littérature qui en traite est abondante.
Conservatoire national des arts et métiers
Architectures des systèmes informatiques
CHAPITRE 1
Origine et évolutions des architectures
Année 2002-2003
![]()
![]()